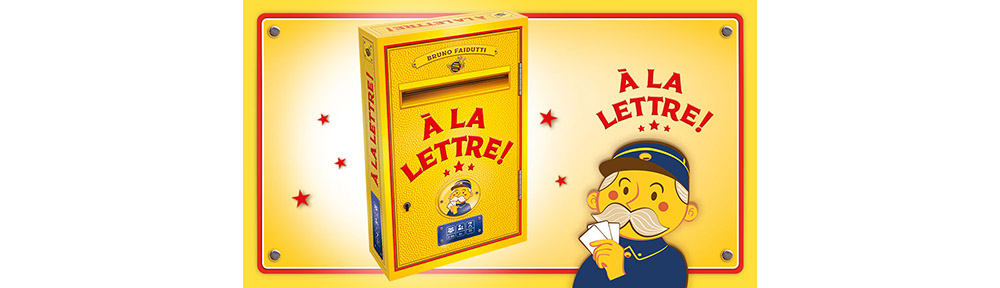À première vue, les relations entre auteurs et éditeurs de jeu semblent très similaires à celles qui lient les écrivains et les éditeurs de livres. Les contrats, les modes de rémunération et, surtout, les relations de confiance propres au secteur culturel et aux milieux de passionnés sont les mêmes.
Différence notable cependant, tandis que le plupart des auteurs littéraires ont un éditeur exclusif qui publie l’ensemble leurs œuvres, les auteurs de jeu sont plus volages. Si l’on excepte Klaus Teuber, dont toutes les créations sont publiées par Kosmos, et les quelques auteurs qui, tel Friedemann Friese, ont fait le choix de toujours s’autoéditer, les auteurs un peu connus ont tous des jeux chez de nombreux éditeurs – Reiner Knizia n’est sans doute plus en mesure de compter les siens. Cela est bien sûr dû à des logiques éditoriales assez différentes dans le livre et dans le jeu. Le lecteur qui apprécie un écrivain sera tenté de lire tous ses livres, et le plus paresseux ou maniaque heureux de les trouver tous aisément au même format et dans la même collection, et l’éditeur littéraire, qui lui aussi a choisi l’auteur parce qu’il l’appréciait, fait donc le choix de la fidélité. Les éditeurs de jeux, même spécialisés, sont au contraire dans une logique de gamme, ce qui suppose des jeux différents qui, même s’ils s’adressent souvent au même type de public, ne soient pas trop susceptibles de se « cannibaliser ». À l’extrême, la gamme d’Asmodée va aujourd’hui des petits poneys mauves aux succubes sanguinolentes. Cela impose aux éditeurs de ne pas publier tous les jeux, même des auteurs qui leur sont les plus sympathiques.
Les contrats proposés aux auteurs par les éditeurs de jeux sont donc généralement des copies conformes de modèles venus d’éditeurs littéraires ; il m’est même arrivé d’en recevoir dans lesquels on avait oublié de remplacer « livre » par « jeu ». C’est flatteur pour l’auteur, et peut aider à l’occasion à faire valoir le caractère culturel de la création ludique.
Ces contrats ignorent cependant curieusement les questions éditoriales, dont nous verrons plus loin qu’elles sont les plus importantes, mais détaillent avec un soin maniaque les aspects financiers. Est ainsi précisé non seulement le pourcentage de droits d’auteur et éventuellement l’avance, mais aussi la manière dont ces droits doivent être versés, les mille et uns recours de l’auteur en cas de non paiement, la juridiction compétente, le tout parfois sur des dizaines de pages d’une précision d’autant plus ridicule qu’il est bien impossible à un auteur quel qu’il soit de vérifier les tirages et les ventes de son éditeur. Bref, sept ou huit pages de contrat pour pas grand chose, tant les désaccords financiers sont rares entre auteurs et éditeurs. Le milieu du jeu réunit en effet des gens honnêtes, des passionnés, et les embrouilles n’y ont guère cours. Cela fait plus de vingt ans que de nombreux éditeurs, français ou étrangers, gros ou petits, publient mes créations. Ce n’est que très rarement que mes droits d’auteur ne m’ont pas été payés. Il a pu arriver que des éditeurs un peu inorganisés oublient un virement en toute bonne fois, mais il suffit alors d’un email ou d’un coup de téléphone pour tout remettre dans l’ordre. Deux ou trois fois des éditeurs ne m’ont effectivement pas payé, mais c’était tout simplement parce qu’ils ne pouvaient pas, et le meilleur des contrats ne m’aurait alors été d’aucune utilité. Bon, en cherchant bien, il y a bien un éditeur que je soupçonne fortement de m’avoir arnaqué, mais c’est l’exception qui confirme la règle, et il a disparu, ce qui prouve bien qu’il y a une justice.
L’éditeur littéraire publie généralement des œuvres auxquelles ils n’est pas en droit de changer la moindre virgule, et le seul texte sur lequel l’auteur n’exerce pas un contrôle absolu est celui de la quatrième de couverture. Cela explique sans doute que les contrats empruntés au monde du livre, s’ils développent largement les questions financières, fassent largement l’impasse sur les aspects éditoriaux, qui sont très différents dans le monde du jeu et sont les seuls à poser régulièrement problème dans les relations entre auteurs et éditeurs – enfin, du moins lorsque je suis l’un des auteurs. Les points de vue différents débouchent alors d’autant plus facilement sur l’incompréhension, puis sur les rancœurs, que les droits et responsabilités respectifs de l’auteur et de l’éditeur n’ont jamais été mis au clair dans ce domaine et que, du fait de l’asymétrie de leurs relations, l’éditeur est en position de force.
Si je n’ai pas souvenir d’avoir eu des accrochages avec mes éditeurs sur des questions d’argent, j’en ai eu beaucoup sur l’édition de mes jeux, qu’il s’agisse du thème et des règles, points sur lesquels aucun contrat ne précise exactement ce que l’éditeur est en droit de changer, ou plus rarement du format et du matériel, points qui relèvent clairement de l’éditeur mais sur lesquels il m’arrive d’avoir des idées bien arrêtées. Je me souviens encore des discussions avec Jürgen Valentiner-Branth, qui travaillait alors chez Schmidt, qu’Alan Moon et moi avons fini par convaincre qu’il ne fallait surtout pas retirer de Diamant la règle selon laquelle la carte danger qui a fait se terminer l’exploration d’une grotte est retirée du jeu, tant elle était nécessaire à l’équilibre du jeu – mais pour un éditeur intelligent prêt à écouter les arguments de l’auteur, combien de têtus refusant d’entendre raison. L’éditeur pouvant plus facilement se passer de l’auteur que l’inverse, et faisant facilement valoir, à raison, qu’il est seul à prendre des risques financiers, il n’est en effet pas toujours facile à un auteur de jeu de se défendre lorsqu’il est hostile aux modifications que l’on veut apporter aux règles ou au thème de son jeu, ou à la manière dont celui-ci va être publié. Voilà pourquoi, si j’exprime maintenant systématiquement mon désaccord, et suis parfois entendu, je n’insiste généralement pas face à un éditeur qui maintient son point de vue – mais c’est sans doute une erreur.
Combien je regrette en effet, avec le recul, d’avoir laissé passer bien, parfois sans rien dire, des petites modifications qui, comme je l’avais pressenti, ont affaibli mes jeux, nuisant souvent à la simplicité et l’élégance des mécanismes, à l’équilibre du jeu ou, c’est le problème le plus fréquent, à la cohérence du thème. Je pourrai presque en trouver un exemple pour chacun de mes jeux publiés. Aurais-je dû crier plus fort, protester plus violemment ? À quoi bon, puisque dans les rares cas où je me suis vraiment énervé, ma colère a été sans effet. Les rares fois où j’avais le sentiment que les changements proposés allaient réellement tuer le jeu, j’ai même proposé de diminuer mes royalties si le jeu pouvait être publié comme je le souhaitais, mais aucun éditeur n’a jamais accepté cette proposition. Que faire de plus ? Refuser de voir mon nom sur la boite ? Menacer de ne pas présenter le jeu sur mon site ? Cela aurait-il été plus efficace ?
Loin de moi pourtant l’idée que l’éditeur devrait systématiquement publier le prototype de l’auteur en l’état. Rien n’est plus frustrant pour l’auteur qu’un éditeur qui, interrogé sur ce qu’il souhaiterait changer à un jeu, répond que tout lui semble parfait. Un nouveau regard, de nouvelles idées, peuvent apporter beaucoup à un jeu et aider un auteur qui n’a pas toujours le recul nécessaire. Les éditeurs, ou les directeurs de collection chez les plus grands, sont des passionnés, souvent auteurs ou anciens auteurs eux-mêmes, et je pourrais citer des jeux aussi nombreux que dans le paragraphe précédent, parfois les mêmes, que leurs idées ont grandement améliorés. Certains, comme Abacus, Alea ou Ravensburger, ont même souvent l’élégance de joindre des commentaires de partie et des conseils de développement aux lettres accompagnant les prototypes refusés et renvoyés.
Bref, j’attends d’un éditeur décidé à publier un jeu qu’il y joue suffisamment, et avec suffisamment d’attention, pour en faire une lecture critique et donc naturellement suggérer quelques changements.
Pour autant, il est clair que nul ne connaît aussi bien un jeu que son auteur, qui a suivi à toutes les étapes de sa conception, en connaît les équilibres sous-jacents, sait le pourquoi de chaque règle, de chaque carte, de chaque case. C’est pourquoi un jeu ne devrait jamais être retravaillé, modifié, développé, tant dans son thème que dans ses mécanismes, que sous la supervision de l’auteur, et ne devrait pas pouvoir être publié s’il ne correspond pas expressément à la volonté de l’auteur.
L’histoire de Broadway, devenu Chicago Poker, est sur ce point édifiante. L’équipe de Phalanx s’est intéressée au jeu, l’a testé avec soin, et a eu deux idées – une excellente et une catastrophique. La bonne idée, modifier le nombre d’établissements en jeu, qui était toujours de trois dans notre prototype, en fonction du nombre de joueurs, améliorait l’équilibre des mécanismes et augmentait sensiblement la tension. La mauvaise, rebaptiser descente de police la carte informateur et colt la carte mitraillette, affaiblissait considérablement le thème du jeu en donnant aux cartes des noms qui n’avaient plus aucun rapport avec leurs effets. On voit aisément à partir de cet exemple quelle aurait été la démarche optimale : l’éditeur teste le jeu, propose les deux modifications aux auteurs, qui acceptent avec enthousiasme la première et expliquent pourquoi la seconde est absurde. On aurait ainsi obtenu un jeu meilleur que le prototype que nous avions originellement proposé à Phalanx. Celui qui a été publié est certes mieux équilibré dans ses mécanismes, mais bien moins cohérent dans son thème.
Quelques éditeurs ambitieux (ou présomptueux) confient le prototype à un développeur maison qui, avec sa propre équipe de joueurs, en fait généralement quelque chose de très différent, qui peut être meilleur ou moins bon, mais ne ressemble qu’assez vaguement au jeu pour lequel un contrat avait été initialement signé. Outre qu’elle est très frustrante pour l’auteur ainsi tenu à l’écart, et génère des tensions entre des parties qui devraient rester toujours partenaires, cette méthode absurde aboutit à une perte de temps et d’énergie considérable, lorsque des voies qui avaient déjà été explorées par l’auteur le sont de nouveau par le développeur, ou lorsque des réglages fins qui avaient demandé de nombreux tests sont tout simplement ignorés.
Quitte à vouloir profondément modifier un jeu, la bonne méthode est celle appliquée, notamment, par Days of Wonder, qui place l’auteur au centre d’un travail de développement mené du début à la fin en collaboration. Le jeu est trituré en tous sens par des testeurs qui n’hésitent pas à être critiques, mais c’est à l’auteur qu’est toujours demandé de faire les modifications jugées nécessaires, ou d’expliquer pourquoi il ne les souhaite pas. Days of Wonder ne publiera finalement pas Cassiopée, le grand jeu de développement et de conquête spatiale que j’ai conçu avec Serge Laget, mais toutes les parties jouées, tous les emails et coups de téléphone échangés lorsqu’ils envisageaient de le faire ont grandement bénéficié au jeu. Et comme Nexus a l’air parti pour travailler de la même manière, on devrait à l’arrivée vous amener un jeu sacrément abouti.
La question cruciale, celle qui pose toujours problème, est donc elle du degré de liberté de l’éditeur en matière éditoriale. Tous les éditeurs (et tous les auteurs sans doute) n’ont pas sur ce point la même opinion et les mêmes méthodes, mais il est assez curieux que les contrats d’édition soient vagues ou muets sur ce point fondamental. La moindre des choses serait, me semble-t-il, de préciser qu’aucun changement ne peut être apporté au thème, aux mécanismes et aux règles du jeu sans l’accord de l’auteur.
Un autre problème récurent est l’information de l’auteur. Il n’est pas normal qu’un auteur de jeu, surtout lorsque, comme moi, il consacre pas mal de temps et d’énergie à tenir à jour un site web sur ses créations, n’ait pas la primeur de l’annonce de la sortie de ses jeux. S’il est normal que j’attende le bon vouloir de l’éditeur pour parler de mes jeux à paraître, il est extrêmement humiliant de découvrir l’annonce de la parution, et parfois les graphismes, sur Tric Trac ou un autre site généraliste.
Bref, il est urgent que tous les éditeurs réalisent que respecter un auteur, ce n’est pas seulement lui envoyer un chèque tous les trois ou six mois, c’est au moins autant le tenir au courant de ce que devient son jeu, et lui faire confiance s’il faut le modifier ou le retravailler. Si l’apport de l’éditeur peut souvent contribuer à mettre la dernière touche à un jeu, nul n’a rien à gagner à maintenir les auteurs à l’écart.
Relations between game authors and game publishers, at first look, seem to be very similar with relations between writers and book publishers. The contracts, the way both publishers and authors earn their living, and the trust based relations specific to most cultural activities, all are the same with games and books.
A first and important difference is that, while most writers have an exclusive and faithful publisher who prints all their new books, game authors look much more frivolous. Except for Klaus Teuber, whose games are all published by Kosmos, and a few strongly willed authors who, like Friedemann Friese, have always self-published their games, game authors all have games brought to the market by many different publishers. Reiner Knizia is probably unable to make a precise list of al his publishers. This is due to he different publishing policies in the game and book worlds. The reader who liked a book by a given writer will be tempted to read all the other ones, and, especially if somewhat lazy or maniac, will be glad to find all of them in the same series and book size. The publisher, who also choose to publish a writer because he liked his books, has good reasons to publish all of them.
While writers-publishers relations are long, faithful and exclusive affairs, infidelities seems to be the norm between game authors and their publishers. The reason is that most publishers have a “product line” approach and try, even when all their games are more or less targeted at the same style of gamers, to have very different games that will not cannibalize one another. That’s the reason why the Asmodée line now goes all the way from small purple ponies to busty bloody succubi, and that means publishers can’t publish all the games of an author, even when they like him really like him..
Contracts submitted to authors by publishers are usually faithful copies of contracts used by book publishers. I even got some in which “book” had not been replaced with “game”. It’s flattering for game authors, and may even help in proving the cultural nature of game design.
Strangely, these contracts usually completely ignore editorial matters, while financial matters are dealt with maniacal details. This means contracts not only state the percent of royalties the author will get, and sometimes the advance he will get, but also when and how this must be paid, what the author can do if not paid in time, how many author copies he can get, what court is qualified in case of troubles, all this in long details covering many pages. This is not only ridiculous, but also totally inaccurate. No matter what the contract says, authors have no practical and realistic way of checking the print runs and sales of their games. Furthermore, money problems between game authors and publishers are extremely rare. The small game publishing world is made of enthusiast game geeks, not the kind of people who will even think of double crossing game authors. In more than twenty years, I’ve designed games and have them published by dozens of publishers. I almost never had any problem with royalty payments. It may have happened than disorganized publishers forgot a payment, but it was always in good faith and one email or phone call was enough to make things straight. The two or three times publishers really didn’t pay me, it was because they could not, and the best contract would have proven totally useless in such situations. Well, there’s one publisher I suspect didn’t pay me what he owed me, but it’s one exception to an otherwise general rule, and it doesn’t exist any more, which is reassuring in a way.
Literary publishers usually don’t move a single coma of the work they publish, and the only text on which they have some control is at he back of the book. That’s probably why contracts borrowed from the book world don’t tell anything about editorial issues and deal only with the financial ones. Things are different in the gaming world, and editorial problems are commonplace between game authors and publishers – well, at least when I am the author. The respective rights and responsibilities of author and publisher have never been clarified. The relations between both parties are strongly asymmetric and the publisher, having the strongest position, can usually enforce his point. Editorial disagreements are therefore never settled in a balanced debate, and usually end in miscomprehension and long lasting rancor.
I don’t remember any real argument with my publishers about money, but I’ve had many about the games themselves. The conflict was usually about the rules or the theme f the game, both points about which no contract ever specifies what the publisher can or cannot change, and sometimes even on the graphics or components, which are clearly the publisher’s responsibility but on which I may have firm ideas. I remember, for example, that Alan Moon and I had to explain at length to Jürgen Valentiner-Branth, who was at this time working for Schmidt, why we didn’t want to remove the rule stating that the danger card that triggers ten end of an exploration is removed from the game, since we thought this rule was essential for the game balance. This time, we were heard and understood, but it’s not always the case.
Unfortunately, since the publisher can more easily resign than the author, and since he can always, and rightly, state that he is the only one risking his own money in publishing the game, it’s often very difficult for the author to argue when he disagrees with the changes that have been made to the rules or theme of his game, or with the way it is going to be published. Therefore, if I now always clearly state my disagreement, and am sometimes successful at once in convincing the publisher, I don’t insist very long when he maintains his point – but that is probably an error.
Afterwards, I almost always regret it, since the changes I didn’t want usually weaken either the elegance and simplicity of the game systems, either its balance, either, and that’s the most frequent problem, the consistency of its theme. I probably can find one such point, be it the name of a card, a new rule, a change in the scoring, for every one of my published games. But what could I do? The few times I started a real and strong argument, my anger had no effect. Two or three times, when I felt that the changes will dramatically damage the game, I even suggested to lower my royalties if the game could be published as I wanted, but no publisher so far accepted such a deal. What more can I do? Forbid to put my name on the game box? Threaten not to tell about it on my website? I’m not sure it would have been more convincing.
This doesn’t mean that publishers ought always to publish the prototypes as they are, even when I can see a few cases where they should have. It’s very frustrating for the author when he publisher just says that the game is perfect and that he doesn’t see a single point he would like to change. Looking at the game from a different and less involved point of view, the publisher can often have different and interesting ideas. Publishers, or product managers when dealing with big publishers, are always game geeks, often former game authors, and I know many games of mine which have been considerably improved by their ideas. Some publishers, like Abacus, Alea or Ravensburger, even have the elegance to send back rejected prototypes with game reports, comments and sometimes development ideas.
I expect from a publisher who intends to publish a game to play it a lot, have a critical view of it, and suggest a few changes or ideas. Nonetheless, the author obviously knows the game best, since he has followed it from its very beginning, is a aware of all the hidden balance and story arc systems, knows why every card, every space, every rule is here. That’s why if changes have to be made, they must be made under the supervision of the author, and a game ought not to be published if it doesn’t fit perfectly with author’s will.
A good example of both the good and bad ways a publisher can alter a game is Chicago Poker. The Phalanx team liked the game, played it a lot, and had two ideas – a great one and a terrible one. The good idea was to modulate the number of establishments in play, which was always three in our prototype, depending on the number of players. This greatly improved the game balance and tension, especially with many players. The bad one was to change the name of two action cards, the Machine Gun and the Informer, and to rename them Colt and Police Raid, names which have no relation with the cards effects in the game. Obviously, the right process would have been to ask us about both changes – we would have enthusiastically agreed for the first one, and strongly opposed the second. This way, the published game would have been much better than our prototype, when the one that was actually published has better balanced mechanisms, but a less consistent theme.
Some ambitious – or you could say presumptuous – publishers give your prototype to an in-house developer who, with his own testing team, will make something very different out of it. It can be better, it can be worse, but it’s usually very different from the game for which a publishing contract was originally signed. This is very frustrating and humiliating for the author who is kept away from his own game, and always brings unnecessary tensions and miscomprehensions between author and publisher, who ought to work as a team. It also makes for a terrible waste of time and energy when, and I’ve seen it a few times, experiments which had already been made by the authors are made again by the developer, or when subtle and invisible balance systems are carelessly destroyed.
I can understand that a publisher will want to make critical changes to a game to have it better fit in his line, but the right way to do this is not in house “development”, it’s the method used, for example, by Days of Wonder. This means that the original author must be kept at the heart of the development process, that the author must be asked to make the adjustments that the publisher wants, or to explain why they can’t be done. Days of Wonder will finally not publish Cassiopeia, the big space empire development game I designed with Serge Laget, but it has been greatly improved by the many games they played, and the many changes we discussed via emails and phone calls, when they were seriously considering it. It seems that Nexus works in the same way, so the game will probably end even better.
The critical issue, the recurrent problem, the source of all misunderstandings between authors and publishers, is how and how far a publisher can change the game designed by the author. Publishers, and authors, don’t have all the same approach and the same methods when it comes to developing or finalizing a game, but it’s strange and problematic that contracts are either mute or nebulous on this absolutely critical issue. The minimal point would be to specify that no change can be made to the game rules and theme without the agreement of the author.
Another recurring problem is simply with keeping the author informed. I spend much time and energy maintaining my website, and try to post on it the latest news about my games – providing I get them in time. It is normal for the author to wait for the publisher’s will before announcing a new game, but I hate to read about it first, and to discover the graphics, on some other gaming website.
To put it short, it’s time publishers realize that they owe some consideration to the authors. This cannot be done simply with a timely wire transfer every few months, and it’s also necessary to keep the author informed of what is happening to his game, and to trust him if the game has to be reworked. Publishers can give good advice and help finalize a game, but it’s neither in their interest nor in the gamers one to keep the author away.