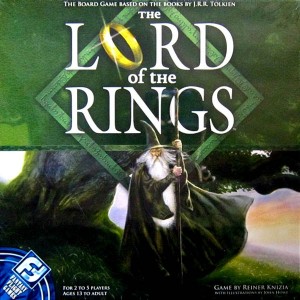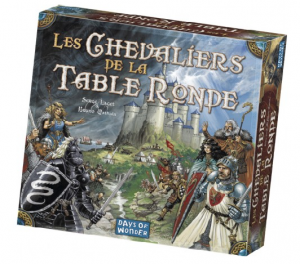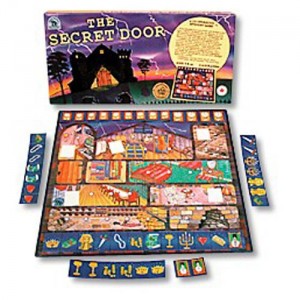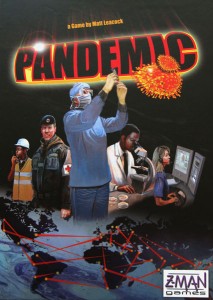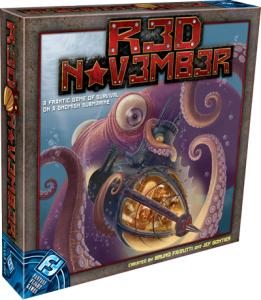La version « Legacy » des Aventuriers du rail, Légendes de l’Ouest, à laquelle je n’ai pas encore joué, a été généralement très bien reçue dans le petit monde du jeu de société. L’équipe qui l’a développé, Alan Moon, Matt Leacock et Rob Daviau, réunit quelques uns des meilleurs auteurs contemporains. Tout ce que j’ai lu me fait envie, et je vais sans doute me le procurer, même si je doute fort de pouvoir jamais réunir une équipe prête à faire les douze parties de la campagne. Sur les réseaux sociaux, ce jeu a fait l’objet de quelques critiques, féroces mais marginales, sur la manière dont il présenterait développement du réseau ferré aux Etats-Unis. Ces critiques me semblent mal fondées, et je ne pouvais pas laisser passer une telle occasion de m’exprimer à la fois en tant que prof, historien, marxiste et auteur de jeux, et de m’étonner une fois encore de la propension de beaucoup, à gauche, à se tromper d’ennemi.
Comme il était difficile de répondre de manière argumentée en 280 caractères, j’ai décidé de développer un peu pour écrire ce post de blog. L’une des trois discussions a rapidement dérivé sur un sujet voisin, mon hostilité aux jeux éducatifs et ma méfiance envers les jeux « à message », même et surtout lorsque je suis d’accord avec le message. J’aborderai donc aussi un peu ce point en deuxième partie.
Certes, la nouvelle version des Aventuriers du rail, un jeu déjà classique, illustre de toute évidence, plus encore que l’original, une version fantasmée de la conquête de l’ouest, des rails sur la prairie. Le jeu, qui s’appelle « Légendes de l’ouest » et non « Histoire de l’ouest » ne s’en cache nullement. Même quelqu’un qui, comme moi, ne connait à peu près rien à l’histoire américaine, ne peut, au simple vu de la boite, avoir le moindre doute. Si cela ne suffisait pas, une note des auteurs dans les règles indique bien qu’ils sont parfaitement conscients de s’être inspirés des clichés (tropes) sur la conquête de l’ouest, lesquels ignorent largement son coût humain aussi bien pour les tribus indiennes que pour les travailleurs. Paradoxalement, cette note a peut-être aggravé le problème – en tant que prof, je sais que c’est souvent une erreur de prendre les élèves pour des idiots en leur disant des choses qu’ils ont déjà comprises.
Malgré cela, certains ont reproché à ce jeu de ne pas être fidèle à la réalité historique, voire d’être un peu raciste, puisqu’il ne met pas en scène les tribus indiennes sur les terres desquelles les voies ferrées ont été construites, et très pro-capitaliste, puisqu’il ne dit rien de l’exploitation des esclaves puis des cheminots pour construire ces mêmes voies. Le jeu n’est bien sûr ni l’un, ni l’autre, puisqu’il ne prétend nullement être historique et assume clairement, ce qui n’est pas le cas de bien d’autres jeux aux vaguement historiques, être fondé sur des clichés.
Cet univers romantique et un peu enfantin est sans doute l’une des raisons qui me donnent envie de jouer aux Aventuriers du Rail – Légendes de l’ouest. Je jouerai peut-être aussi avec plaisir à un jeu sérieux et militant prétendant « démystifier » la conquête de l’ouest en détruisant des clichés que personne ne prend plus vraiment au sérieux, mais je n’en suis pas certain car ce serait un autre jeu visant un autre public.
La vision romantique et fantasmée de l’histoire américaine qui apparaît dans Les Aventuriers du Rail mérite certainement d’être utilisée avec prudence, ce qui est le cas dans ce jeu, et éventuellement d’être étudiée et analysée. Je m’y étais un peu essayé il y a une dizaine d’années dans mon essai sur Décoloniser Catan, puis dans un article sur les jeux de trains. En français, des études critiques sur l’imaginaire médiéval dans les jeux ont été publiées ces dernières années, notamment par Anne Besson, centrées sur les jeux de rôles et les jeux video ; la conquête de l’ouest, même si le thème est moins prégnant dans le jeu de société, mériterait le même traitement. Des universitaires américains travaillent sans doute sur le sujet ; je n’ai pas vraiment cherché, mais si on m’envoie un article sérieux, je le lirai avec plaisir.
Les critiques ne reprochent en fait pas vraiment à ce jeu de ne pas être historique, ils le condamnent surtout pour ne même pas essayer de l’être, pour ne pas prendre son thème au sérieux. Si j’ai pu apprécier quelques jeux au thème historique très sérieux, comme récemment Pax Pamir, je n’ai jamais confondu une partie de jeu et un cours d’histoire. J‘ai dans un coin de ma tête une vague idée de jeu de cartes sur les débuts de l’ouverture du Japon vers l’Ouest dans les années 1850, mais si ce projet aboutit, le ton en sera sans doute plus léger et ironique. Bon, j’espère que Cole Wehrle ne va pas m’écrire qu’il a déjà commencé à bosser sur ce sujet, qui lui irait assez bien.
En regardant sur les étagères où se trouvent mes jeux publiés, je n’en vois que trois au thème vaguement historique, Mystère à l’Abbaye, La Vallée des Mammouths et Silk Road. Aucun des trois, c’est le moins que l’on puisse dire, n’a le moindre contenu historique un peu sérieux.
L’idée que les jeux de société devraient toujours prendre leur thème au sérieux me gène énormément. Elle implique en effet que, contrairement aux auteurs et aux critiques, les joueurs ordinaires seraient des idiots incapables de regard critique, de faire la différence entre l’histoire et la légende, entre le premier et le second degré. Elle sous-entend surtout que les jeux tireraient leur valeur de leur caractère éducatif. J’ai déjà sur ce site expliqué pourquoi je n’utilise pas les jeux dans mes cours, et pourquoi je considère l’idée même de jeu éducatif comme un oxymore dévalorisant aussi bien pour les enseignants que pour les auteurs de jeu.
On peut apprendre très efficacement l’histoire en lisant des livres d’histoire. On le peut encore, même si cela prend beaucoup plus de temps, en lisant des romans, en regardant des films, en pratiquant certains jeux video ou jeux de rôles, si l’on prend garde à ce que l’intrigue ne prenne pas le pas sur le contexte. Les jeux de société, entièrement centrés sur leurs règles, peuvent difficilement avoir la même profondeur psychologique, la même subtilité dialectique, ou même simplement apporter la même quantité d’informations. C’est pour la même raison qu’il est rarissime qu’ils parviennent à faire passer un message politique sans sombrer dans la caricature.
J’ai déjà bien du mal, dans mes cours, transmettre tout le contenu sur lequel je souhaite faire réfléchir mes élèves, je n’y parviendrais jamais si je devais utiliser comme médiateur un outil aussi complexe et rigide qu’une règle de jeu. Je n’ai pas de temps à perdre avec des règles, et j’ai besoin de la souplesse, des possibilités d’improvisation, de discussion et d’adaptation que seul le cours oral peut apporter. Pax Pamir, sans doute le plus réfléchi et le mieux documenté des jeux de société sérieusement historiques auxquels j‘ai joué, et celui auquel j’ai leplus pris de plaisir, demande deux heures de jeu pour un contenu qui tiendrait sur un article d’une vingtaine de pages ou un podcast d’une demi heure . C’est un excellent jeu, surtout quand on connaît déjà un peu son thème, mais c’est un outil pédagogique bien peu performant. On peut d’ailleurs finir la partie sans savoir qui a gagné (les anglais ont perdu, les russes n’ont pas vraiment gagné).
Il y a une dizaine d’années, je terminais mon essai sur le tropisme colonial dans les jeux de société en expliquant que le problème était moins le recours aux clichés historiques et/ou exotiques que le fait que ce recours soit parfois inconscient et trop rarement assumé et/ou ironique. Au vu des évolutions récentes du petit monde du jeu, je pense que j’aurais dû insister plus encore sur ce dernier point. Dans Les Aventuriers du Rails – Légendes de l’Ouest, les clichés sont parfaitement conscients et revendiqués. Comme le remarque une astucieuse critique, le jeu ne donne pas une vision biaisée de l’histoire, il s’en débarrasse et la jette par la fenêtre. Beaucoup d’auteurs, moi le premier, procèdent fréquemment ainsi, et ceux qui le font consciemment et le revendiquent sont ceux auxquels il est le moins légitime de le reprocher.
Dans l’une des trois discussions sur Twitter et Bluesky qui sont à l’origine de cet article, Cole Wehrle, auteur notamment du très sérieux Pax Pamir et du plus ironique Root, a très bien résumé le problème : « je pense que nous condamnons trop facilement des jeux, alors qu’il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils ignorent un point particulier. Il n’en reste pas moins important d’analyser les jeux (et les livres) et de s’interroger sur les effets de leurs mises en scène. »
The legacy version of Ticket to Ride, which I’ve not played yet, seems to be very well received in the small gaming world, which is not surprising given the great team of designers, Alan Moon, Matt Leacock and Rob Daviau. Everything I’ve read about it makes me want to play it, and I will certainly get a copy soon, even when I doubt being able to get a stable team of players ready to play the twelve parts of the campaign. On social networks, however, there has been some marginal but fierce criticisms of the way it is describing the rail network development in the US. I think these criticisms are ill-founded.
I could not let pass an occasion to speak at the same time as a historian (with a PhD), a teacher (of social sciences), a Marxist (though not always the most orthodox one) and a game designer (with nearly a hundred games under my belt), and to highlight the growing propension of many western leftists to pick the wrong enemy. Since it was hard to really explain my point in 280 characters, better write a blog post. One of the three simultaneous discussions on the subject rapidly digressed on a slightly different topic, my hostility to educative games and my reluctance to games trying to deliver a message – even and may be even more when I agree with the said message.
The action in Ticket to Ride – Legends of the West obviously takes place in a romantic fantasied version of the American frontier story, rails on the prairie. The game doesn’t try to hide this – it’s named “Legends of the West”, not “History of the West”. Even someone like me, who knows nearly nothing of American history, should notice it at first glance. If there were still doubts, a larged boxed paragraph in the rules even specifies that the game is inspired by tropes of the old west, which ignore the human cost for both Indian tribes and rail workers. Paradoxically, this note might have aggravated the issue – as a teacher, I know it’s usually a bad move to take students for idiots with telling them what they obviously already know. On the other hand, well, you never know exactly who will play your game.
Despite these carefully laid caveats, the game has been criticized for not being historically faithful, or even for being vaguely racist, since it doesn’t feature the native tribes whose territories these tracks were laid on, and definitely pro-capitalist, since it ignored the exploitation of slaves and other rail workers in building the network. It is neither one nor the other, since it doesn’t pretend to be historical, and the designers clearly assume having built it on clichés and tropes. And, yes, this romanticized and even a bit childish background is one of the reasons why I’m eager to play this new Ticket to Ride. I might enjoy as well a more serious and political game aiming at debunking the American railway myths, but I’m not sure of it and, anyway, it would be a completely different game aimed at a different market niche.
The fantasy version of the American railway history which appears in Ticket to Ride – Legends of the West certainly requires to be used with care, but it clearly is here, and even to be studied and analyzed. I vaguely touched on this a dozen years ago in my essay about Postcolonial Catan, before the idea was fashionable, and in a blogpost about train games. I’ve read a few interesting academic studies of the image of the Middle Ages in games, though in French and mostly about video and role-playing games, among others by Anne Besson. Even when it is a less pervasive setting, the old west certainly deserves the same type of research. I bet there are already American scholars working on it, and if someone sends me an article, I will gladly read it.
In the end, what some critics reproach to the new Ticket to Ride is not that it is not historically faithful, it is that it doesn’t even try, that it doesn’t consider its setting to be something serious.
I have enjoyed a few serious historical games, the last one being Pax Pamir, but I have never considered them to be a lecture in history. I have a very vague idea for a card game about the opening of Japan to the West in the 1850s, but if I ever finish it, it will probably have a more tongue in cheek feel. Well, let’s hope I won’t get a mail from Cole Wehrle saying he’s already working on this topic, which would fit him quite well.
When I look up at the shelves with my published games, I see only three with vaguely historical settings, Mystery of the Abbey, Silk Road and Valley of the Mammoths. None has the slighest amount of serious historical content or discourse, even when I could have done it for the first one.
As an historian who, for forty years, has mostly designed game based on ridiculous fantasy settings, I find the idea that games should always take their setting seriously very disturbing. It implies that, unlike game designers and reviewers, average gamers are unfazed idiots, unable of any critical view, unable to make the difference between fantasy and history. It is also linked to the idea that the value of games is in their educational use. I have already explained on this blog why I consider the idea of « educational games » to be an absurdity which belittles both game designers and teachers.
One can learn history very effectively with reading history books. One can learn some bits of it with reading novels, watching movies or playing some video or role playing games, providing one is careful not to let the intrigue take over the context. Boardgames, being terribly rules-centric, cannot have the same psychological depth, the same dialectical subtlety, or even only bring the same amount of information. For this same reason, boardgames are not really adapted to the transmission of political messages, and those which try do it usually end up being simplistic.
I already struggle to bring to my students all the content I want them to think over, I cannot imagine having to do this through a media as rigid as game rules. I’ve no time to lose on rules, and I need the free-form flexibility, the possibility to react, discuss and improvise which only exists in oral and relatively freeform lectures. Even Pax Pamir, the best example I’ve played of a well thought out and documented historical boardgame, and one I'(ve had great pleasure un playing, takes two or three hours to bring the content one could learn reading a 20 pages article or listening to a 30 minutes podcast. It’s great to play as a game, especially if you already have some knowledge of the subject. it’s inefficient as a teaching tool.
A dozen years ago, i ended my long blogpost, or short essay, on the colonial tropes in boardgames with explaining why the real issue was not the use of historical / exotic clichés but the fact that this use was too often unconscious and too rarely assumed and/or ironic. In the light of what a part of the boardgaming scene has become since, I think I should have emphasized the last point even more. Anyway, in Ticket to Ride – Legends of the West, the clichés are conscious and assumed. It doesn’t give a wrong or biased version of history, it gets rid of history and throws it out of the window (see this clever review). That’s what most game designers do, and I don’t think it can be reproached to those who do it honestly and clearly.
Cole Wehrle, designer of the very serious Pax Pamir and the more tongue in cheek Root, summarized this very well in one of the three simultaneous Twitter and Bluesky discussions which made me write this blogpost « I think we often are too quick to call out erasure when, in fact, there are other good reasons why a game is not covering a particular element. Of course, I still think it’s important to scrutinize games (and books) and to consider the consequences of their framing. »