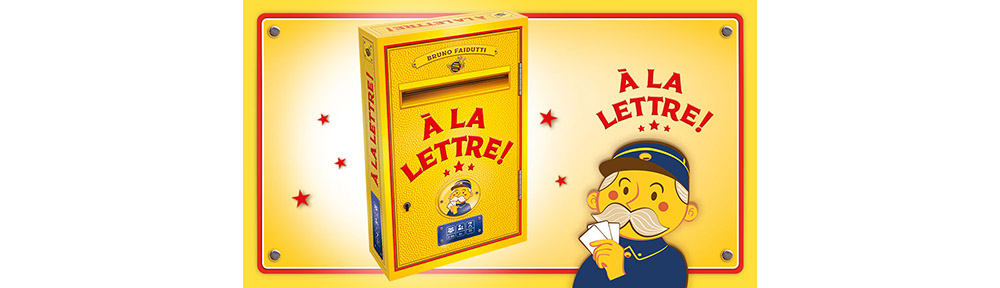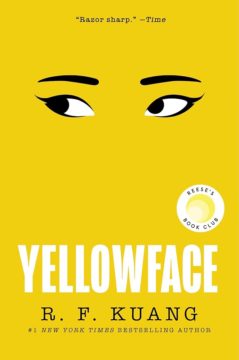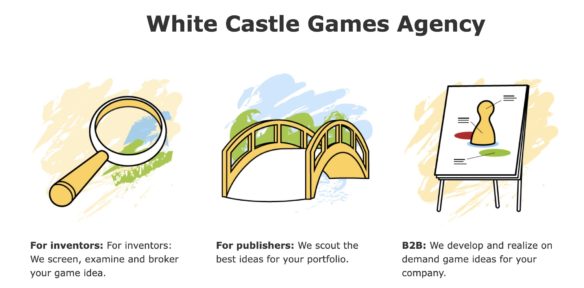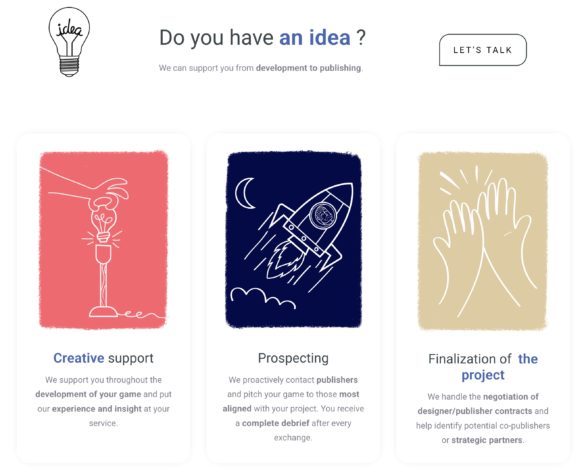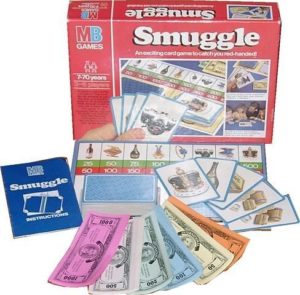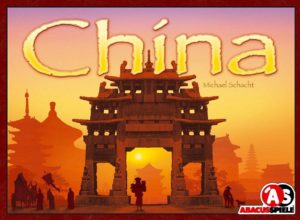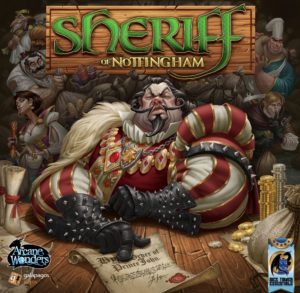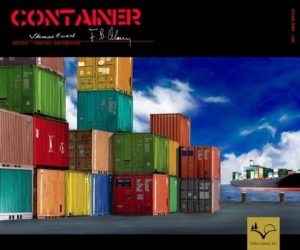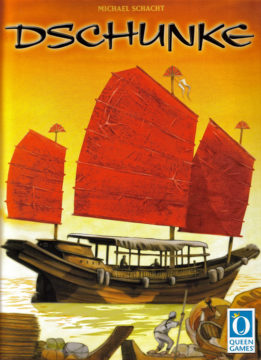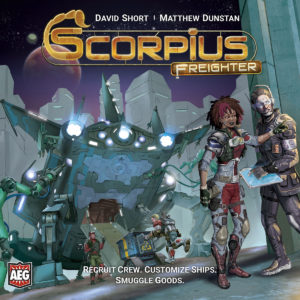J’étais il y a deux semaines en Pologne, à Bydgoszcz, invité à un colloque universitaire consacré à la question de l’analyse des jeux, qu’ils soient en bits et pixels ou en bois et carton. Je ne suis presque jamais invité à ce type d’événement, quasiment jamais en France. Les praticiens du jeu y sont rarement conviés, comme si les universitaires craignaient que nous risquions de polluer leurs recherches par des considérations trop terre à terre. Ma méfiance souvent exprimée face au jeu pédagogique et aux discours sur l’utilité sociale et politique du jeu, des thèmes portés aujourd’hui aussi bien par les grands éditeurs qui financent certains de ces événements que par les universitaires qui s’en veulent les plus critiques, n’aide sans doute pas non plus.
Quoi qu’il en soit, j’ai volontiers accepté l’invitation, et préparé une intervention dans laquelle je m’efforçais de montrer les limites de l’analyse des jeux de société, qu’il s’agisse d’analyse sociale et politique à la manière ce qui se pratique en littérature, ou d’analyse formelle. Je me suis donc trouvé un peu en porte-à-faux par rapport à la plupart des autres interventions, mais j’ai aussi découvert un univers sympathique, et que je connaissais assez mal, celui des universitaires travaillant sur le jeu.
Avant d’écrire ce bref compte-rendu, j’ai donc pris le temps de lire quelques livres cités lors des présentations auxquelles j’ai assisté, Playing Oppression de Mary Flanagan, Cardboard Ghost de Annabel Holland, auxquels j’ai jouté le récent livre d’Henri Kermarec, Ce n’est qu’un jeu. Pour revenir un peu réel, j’ai aussi relu en diagonale quelques-uns des essais d’Umberto Eco dans Les limites de l’interprétation, et mon point de vue n’a donc pas beaucoup changé.
D’innombrables écrivains se sont opposés à la surinterprétation de leur œuvre. Une rapide recherche internet me donne des citations de Tolkien, Nabokov, Gombrowicz, Camus, Kundera, Sontag, Calvino, Houellebecq et Ernaux, j’en trouverai sans doute d’autres si je cherche encore demain. J’ai choisi dans mon intervention de citer Witold Gombrowicz, pour qui la forme imposée par l’analyse critique s’oppose à ce qu’il appelle le chaos, l’expérience de la lecture. J’ai fait ce choix parce qu’il était polonais, et donc connu de mon auditoire, parce que c’est un auteur que j’apprécie, mais aussi parce que sa critique s’applique encore mieux au jeu qui, moins fini que le livre, peut être vu comme une machine à créer des expériences.
Bien sûr, cela ne signifie en rien que l’analyse soit impossible, et donc nécessairement fausse ou illégitime. Je me suis moi-même livré ici à plusieurs reprises à des analyses socio-historiques de certains thèmes de jeu. Mon article Postcolonial Catan, en 2014, a contribué à lancer le débat sur le colonialisme et l’orientalisme dans les jeux de société, et est d’ailleurs cité à plusieurs reprises par Mary Flanagan et Henri Kermarec. Plus récemment, j’ai tenté le même type d’analyse sur les thèmes de la nature et des animaux, qui me semblent avoir largement pris le relais de l’exotisme géographique, et je suis un peu déçu d’avoir été moins suivi.
Cela signifie simplement qu’il faut éviter une analyse trop pointilliste, qui irait analyser individuellement chaque jeu dans les moindres détails en allant chercher partout du sens, voire une intention de l’auteur. Comme en politique, l’intentionnalisme conduit à la surinterprétation paranoïaque. L’auteur n’a souvent pas d’autre intention que de faire un jeu excitant et intéressant. Si je prends mes propres jeux, il n’y en a qu’un seul, Terra, qui ait un message politique explicite, l’idée que les égoïsmes nationaux ne peuvent suffir à régler les problèmes globaux, et c’était plus ou moins une commande. Il y a peut-être un vague message implicite dans Kamasutra, l’idée que notre société prend le sexe trop au sérieux, mais cela ne va pas plus loin.
La démarche des chercheurs travaillant sur le jeu consiste le plus souvent à utiliser des outils venus de l’analyse littéraire. C’est flatteur pour les auteurs, qui, moi le premier, n’aiment rien mieux qu’être comparés à des écrivains, et c’est, dans une certaine mesure, pertinent. C’est ce que je faisais moi-même dans mon article Postcolonial Catan, largement inspiré par la lecture d’Edward Saïd. Il n’empêche que certaines des critiques souvent faites à l’analyse littéraire sont plus pertinentes encore quand il s’agit du jeu, et surtout du jeu de société. Plus encore que les livres, les jeux de société sont de petits mondes clos, aux règles simples et connues, et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’on les pratique, pour échapper un peu à notre monde ouvert aux règles complexes et mystérieuses, si tant est qu’il en ait. J’ai récemment, pour la première fois, animé une activité jeu de société en prison, et j’ai vu dans l’enthousiasme communicatif des prisonniers une preuve de plus que l’on ne joue guère que pour sortir du réel, pour s’évader – sans jeu de mots. Il est vain de chercher dans un jeu de société la même profondeur, les mêmes sous-entendus, que dans un roman, ou même dans un film. C’est moins vrai des jeux de rôles ou des jeux vidéo, du moins des plus sophistiqués d’entre eux, qui peuvent avoir une vraie dimension romanesque, et des qualités littéraires.
Cela permet de rebondir sur un vieux débat du jeu de société, celui du thème et des mécanismes. Peu importe que la conception du jeu soit « partie du thème » ou « partie des mécanismes », il est assez fréquent que le thème d’un jeu, l’univers dans lequel se situe l’action, soit modifié au cours de son développement. C’est d’ailleurs, je pense, la principale cause de friction entre auteurs et éditeurs, bien avant les questions financières. Cela n’arrive bien sûr pas pour un roman, et l’on n’imagine pas un éditeur demandant à un romancier de déplacer dans l’Angleterre victorienne ou dans l’espace profond un récit se déroulant dans l’antiquité grecque…. Tout au plus demandent-ils parfois de retravailler le texte pour le rendre plus long ou, plus fréquemment si j’en crois mes amis écrivains, plus court. On ne peut donc présumer que les mécanismes d’un jeu délivrent une opinion un peu subtile sur son thème.
J’ai pris comme exemple dans mon intervention mon tout dernier jeu sorti, Harvest Valley. Dans prototype initial, des prêtres dans un univers médiéval essayaient d’attirer dans leur paroisse les ouailles fréquentant les églises voisines – j’avais peut-être quelque chose à dire sur le ridicule et l’absurdité de la religion, mais cela n’allait pas bien loin et n’était guère argumenté. Dans jeu finalement publié, les joueurs sont des fermiers qui cherchent à installer leur ferme dans les coins les plus propices à la culture des légumes, des fruits et des céréales. Je n’ai absolument rien à dire sur l’agriculture, sujet sur lequel je suis totalement ignorant, mais je sais très bien que cela ne se passe pas du tout dans la réalité comme dans mon jeu, et notamment que l’on construit généralement la ferme avant de planter les carottes et de semer le blé.
D’ailleurs, à quoi ressemble vraiment le travail d’un auteur de jeu de société ?
– À celui d’un écrivain, et s’agit-il alors plutôt d’un essayiste s’efforçant de faire passer un message ou de répondre à une question, ou d’un romancier racontant une histoire, avec parfois quelques sous-entendus ?
– À celui d’un cuisinier qui mélange des ingrédients pour obtenir le meilleur plat, et s’efforce de le présenter au mieux. Le statut culturel de la cuisine est d’ailleurs discuté un peu comme celui du jeu.
– À celui d’un compositeurs dont les œuvres, si elles ont un titre et un vague thème, restent fondamentalement abstraites. Un morceau musical est, comme un jeu, délibérément clos.
– À celui d’un architecte, qui crée des lieux sans savoir avec précision quelle expérience, quel usage en sera fait ?
Ne sachant pas très bien où je débarquais, j’ai aussi abordé dans ma présentation les limites de l’analyse formelle, mathématique, des jeux. De manière assez intéressante, la critique de Gombrowicz, l’idée que l’attention à la forme peut amener à ignorer l’expérience, est également pertinente ici. La première limite, évidente, est dans le rôle du thème, et ce même quand il n’est guère qu’une astuce pour expliquer les mécanismes du jeu, mais il n’y a pas que cela.
J’ai pris comme principal exemple l’un des meilleurs jeux que j’aie rapporté cette année du salon d’Essen, Whirly Derby. À chaque tour, après avoir pris connaissance des cartes qui iront aux premier, deuxième et troisième de la course, chacun mise un certain nombre de billes à sa couleur, qui sont mélangées dans un cornet de carton avant d’être lâchées dans une sorte d’évier métallique, pour en sortir une à une par un petit trou. Cela pourrait être un jeu de cartes, et c’en était peut-être un à l’origine – chacun joue un certain nombre de cartes à sa couleur, elles sont mélangées et on pioche les trois premières. Je soupçonne même un peu que le premier prototype du jeu était un jeu de cartes. Mathématiquement, c’est la même chose – ce que l’on appelle un isomorphisme – mais il est évident que ce serait beaucoup moins drôle avec des cartes.
Bref, pas de problème, il est parfaitement légitime, et souvent intéressant et amusant, d’analyser les jeux de société, leurs thèmes, leurs mécanismes, leurs matériels et les liens entre tout cela. Cela peut nous aider à les comprendre, et à concevoir de meilleurs jeux à l’avenir. Il faut cependant se garder de les surinterpréter et, surtout, de prendre nos analyses trop au sérieux, de croire qu’elles nous livrent l’essence des jeux.
I was two weeks ago in Poland, in Bydgoszcz, where I had been invited to take part in an academic conference about the analysis of games, be they made of bits and pixels or of wood and cardboard. I am seldom asked to take part in such meetings, and almost never in France. Boardgame designers and players are rarely invited at academic conferences, as if academics were worried we could endanger their research with trivial or concrete matters. I also have expressed quite often my wariness towards educational games, and towards the idea that game should aim at social or political utility, ideas which are popular both among the publishers who fund some of the research on games and among the most critical academics, and this probably doesn’t help either.
Anyway, I gladly seized the opportunity to have a look at this exotic world. Iaccepted the invite, and prepared a keynote in which I tried to show the limits of boardgame analysis, be it sociopolitical analysis akin to what literary critics do, or more formal analysis. This went a bit against the domineering trend of the conference, but the mood was friendly and I met many interesting people among academics working on boardgames.
Before writing this short report, I took the time to read some of the books cited in the various talks I attended, namely Mary Flanagan’s Playing Oppression andAnnabel Holland’s Cardboard Ghost, as well as, in French, the recent book by Henri Kermarec, Ce n’est qu’un jeu (It’s Just a Game). I also reread diagonally (do you say this in English) some of Umberto Eco’s essays in The Limits of Interpretation, and my opinion didn’t change much.
Countless novelists have opposed what they felt was an overinterpretation of their works. A quick web research brought me quotes from Tolkien, Nabokov, Gombrowicz, Camus, Kundera, Sontag, Calvino, Houellebecq and Ernaux, I could probably find more if I search again tomorrow. The only one I quoted in my talk was Gombrowicz, who claims that the form imposed by critical analysis goes against what he calls chaos, the experience of reading. I chose him because he was polish, and therefore well known by most of the listeners, because he’s one of my fetish writers, and because his criticism is even more relevant about games which, even more than novels, can be described as machines aimed at generating experiences.
Of course, this doesn’t mean that any analysis is impossible, and therefore always wrong or illegitimate. I have myself written here a few blogposts trying to analyze sociologically, politically and historically some gaming trends. My essay Postcolonial Catan, in 2014, helped kickstart the discussion about colonial and orientalist settings in boardgames, and is quoted as such by Mary Flanagan and Henri Kermarec. More recently, I tried to make a similar analysis of the nature and cute animal settings, which have largely replaced geographical exoticism, and was a bit disappointed when it got less attention.
What I’m saying is only that we should avoid a nit-picking analysis looking everywhere for meaning, if not for a designer’s intention. Like in politics, paranoid intentionalism leads to overinterpretation. Most times, the author’s only intention is to design a fun and/or interesting game. Among my own designs, more than a hundred, there’s only one, Terra, with an explicit political message, the idea that national egoisms cannot solve global problem, and it was more or less made on order. There might be a vague implicit message in Kamasutra, the idea that western societies take sex far too seriously, but it doesn’t go very far.
Most academics working on games are using tools borrowed from literary criticism. It’s flattering for designers like me, who love being compared with novelists, and it is, to some extent, relevant. That’s what I have done in my Postcolonial Catan essay, largely inspired by a reading of Edward Saïd’s Orientalism. Many of the writers’ complaints about literary analysis are even more relevant when discussing games, and especially boardgames. Boardgames are, even more than novels, small closed worlds with simple and known rules, when the vast and open reality has complex and mysterious rules, if it has any. I recently held, for the first time, a boardgame animation in prison. I saw in the contagious enthusiasm of the attendees one more proof that we play mostly to escape reality, no pun intended. There is no point in searching in a boardgame for the same depth, the same subtleties, the same implied ideas as in book, or even a movie. This is less true of video games and role-playing games which, at least for the most complex of them, can have a true literary dimension.
Let’s come back to the evergreen question about boardgame design – what comes first, what makes a game, theme/setting or mechanisms. No matter whether the designer started with one or the other, the setting is often modified, or even entirely changed, during the development. It is even, I think, the main friction point between designers and publishers, long before money issues. This never happens with novels, and one cannot imagine a publisher asking a novelist to move to victorian Britain or deep space a story set in Ancient Greece. At most, they will ask to make the book longer or, more usually, shorter. This is why one should not presume that the mechanisms of a game express a subtle opinion about its setting. In my talk, I used as an example my very last published game, Harvest Valley. In the original prototype, players were priests trying to lure into their church the peasants and knights from nearby parishes. I might have had something to say about the ridiculous absurdity of religion, but it was neither deep nor solidly argued. In the published game, players are farmers trying to place their farms in the best spot of the valley, where they can grow vegetables, fruits and cereals. I have absolutely nothing to say about agriculture, a topic of which I am nearly completely ignorant – though I know that, unlike in my game, one builds a farm before planting crops.
And, by the way, what is a boardgame designer’s job really like?
– That of a writer, and in this case is it more that of an essayist trying to convey a message or answer a question, or that of a novelist who only wants to tell a story, sometimes with a few innuendos?
– That of cook mixing ingredients trying to make the best meal, and then to present it in the best way ? The cultural status of cooking recipes is ambiguous and discussed in the same way as that of games.
– That of a musical composer whose works, if they often have a name and sometimes a vague setting, are nevertheless fundamentally abstract. A musical composition is, like a game, a completely closed system.
– That of an architect designing places without knowing exactly how they will be experienced.
Not knowing exactly what was to be discussed, I also talked a bit about the limits of a formal, mathematical analysis of games. Interestingly, Gombrowicz’s idea, that focusing on form leads to ignore the most important, the experience, is also relevant here. The first limit, obvious, is the setting/theme of a game, and this even when it is little more than a trick used to make explaining the rules of the game simpler and faster, but there are other ones.
My main example was one of the best games I brought back from this year’s Essen fair, Whirly Derby. Every round, after the cards that will be won by the owners of the first, second and third in the race, each player puts a certain number of marbles in their color into a cardboard cone, where they are shuffled before being poured into a kind of metallic sink, as you can see in the picture. This could have been a card game – every player plays a certain number of cards in their color, which are then shuffled before drawing the three top ones. I even suspect the first prototype of the game was a card game. Mathematically, it is the exact same thing, but everyone who has played this game realize that it would not be half as fun with cards.
Analyzing games’ settings, mechanisms and components, and the relations between these elements, is perfectly legitimate, often interesting and even sometimes fun. It can help us understand games, and therefore design better ones. We must nevertheless be wary of overinterpretation, and be carefuyl not to take ours analysis too seriously, not to think they reveal the true essence of games.