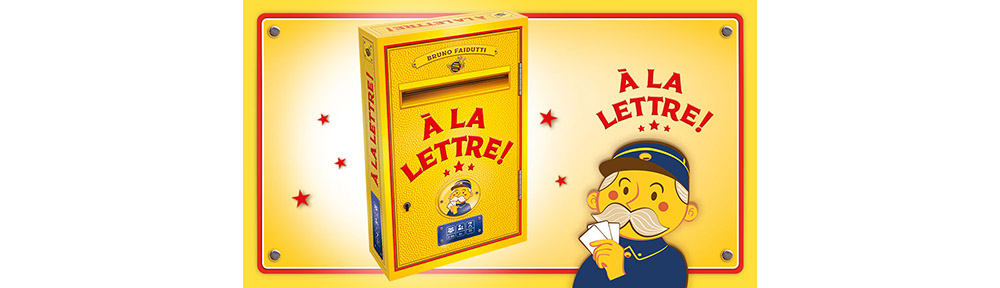Si les Hasbro et autres Mattel, font depuis longtemps fabriquer en Chine ou dans d’autres pays d’Asie certaines pièces de leurs jeux, la plupart des éditeurs de jeux de société, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, avaient coutume de produire leurs jeux chez eux. Quelques uns, comme Ravensburger, ont leurs propres usines, mais la plupart font appel à des cartiers, dont le plus important est le belge Carta Mundi, ou des à des cartonniers / imprimeurs / metteurs en boite / stockeurs et toutes ces sortes de choses, le plus connu étant l’allemand Ludofact.
Depuis deux ans environ, la tendance à la délocalisation de la fabrication des jeux, essentiellement vers la Chine, s’est très sensiblement accélérée, et ne concerne plus seulement les « majors » du jeu. C’est ainsi que si certains de mes jeux sont encore produits en Europe ou en Amérique, ils sont de plus en plus nombreux à porter quelque part au dos de la boite un discret « made in China ». L’édition américaine de Citadelles est maintenant imprimée en Chine, tout comme celle de La Fièvre de l’Or, les pièces du nouveau tirage de Babylone, et maintenant Warrior Knights.
Les éditeurs de jeux « coupables » de délocaliser ainsi leur production sont régulièrement critiqués sur les forums internet, et singulièrement sur les forums francophones. La question est pourtant bien plus complexe que pourraient le laisser croire les imprécations des donneurs de leçons.
La première critique porte sur la qualité de fabrication. Les cartes « made in China » seraient moins épaisses, moins bien vernies, difficiles à mélanger, et leurs couleurs, trop mates ou trop brillantes selon les cas, jamais fidèles. Les plateaux de jeu imprimés en Chine auraient trop souvent sur leur pliure ce vilain creux qui fut longtemps appelé « American Valley », les imprimeurs européens étant les seuls à maîtriser la très haute technologie du pliage de plateau de jeu en quatre. Certains intégristes peuvent même disserter sur la supériorité du « vrai » tramage des boites de jeux imprimées en Allemagne sur le « faux » tramage des boites imprimées en Chine. Moindre, la qualité serait aussi très irrégulière, ce qui obligerait à tout surveiller, tout vérifier, tout recompter en permanence pour éviter de voir arriver des boites auxquelles il manque des pions ou des dés. Pour le respect des délais, les chinois ont aussi plutôt mauvaise réputation, mais les belges ne valent pas toujours mieux. En cas de problèmes, qu’il s’agisse de qualité, de délais où de tout autre problème, les contacts sont en outre plus difficile qu’avec des voisins.
Rien de cela n’est tout à fait faux. Les problèmes de qualité et, surtout, de suivi, expliquent d’ailleurs que certains éditeurs, après avoir produit quelques jeux en Chine, reviennent au moins en partie vers l’Europe et les États-Unis. Je préfère donc généralement voir mes jeux produits en Europe qu’en Chine, car mes contacts occasionnels avec les gens de LudoFact ont toujours été très sympathiques, et car la qualité de fabrication reste généralement supérieure « chez nous ». Le succès de Diamant s’explique, entre autres, par le superbe matériel « made in Germany ». La comparaison n’est en revanche pas toujours favorable aux productions américaines (ou françaises), comme le montre le dernier tirage de l’édition en langue anglaise de Citadelles, imprimé désormais en Chine. Sa qualité reste moindre que celle des éditions européennes, mais est meilleure que celle des tirages précédents qui venaient, je crois, du Canada. Il est cependant clair que ce différentiel de qualité entre l’Europe et la Chine tend à disparaître et que, déjà, plus grand chose ne distingue un jeu produit en Chine d’un autre fabriqué en Europe.
Les critiques les plus fréquentes et les plus violentes ne portent cependant pas sur les jeux eux-mêmes, mais sur la logique économique derrière cette délocalisation. Les éditeurs qui font faire leurs jeux en Chine ne seraient tous que d’affreux capitalistes sans scrupules, coupables tout à la fois de profiter d’une main d’œuvre surexploitée et sous payée et de créer du chômage en Europe et aux Etats-Unis. Là encore, le raisonnement n’est pas entièrement faux, mais il est incomplet.
Oui, les délocalisations suppriment les emplois correspondants dans les pays riches, mais la baisse de prix qu’elles entraînent se traduit aussi par un transfert de pouvoir d’achat vers d’autres secteurs d’activité, transfert qui peut être créateur d’emploi, surtout si ces activités sont des services moins automatisés que l’impression et le découpage du carton. La question du bilan global en termes d’emploi est donc loin d’être simple, car lorsque vous payez vos jeux moins chers, vous en achetez plus ou, plus vraisemblablement, vous achetez plus d’autre chose.
Oui, la raison d’être des délocalisations, dans le jeu comme ailleurs, est dans le différentiel de coûts de production. Imprimer des jeux en Chine n’est intéressant que parce que c’est moins cher, et même suffisamment moins cher pour compenser les coûts logistiques supplémentaires, et cela s’explique avant tout par des salaires plus faibles, des horaires plus lourds et une protection sociale bien moindre. Non, cela ne signifie pas qu’il faudrait, comme je l’ai lu sur certains forums, soit exiger que les travailleurs chinois soient payés au tarif européen et bénéficient des mêmes avantages, soit renoncer entièrement à toute délocalisation. Procéder ainsi reviendrait en fait à neutraliser ce qui reste le principal avantage compétitif des industriels chinois, et donc ce qui permet à la Chine de connaître aujourd’hui une forte croissance. Leur retirer cet avantage au nom des normes sociales occidentales, c’est interdire le développement, et ses conséquences en termes de démocratisation et de progrès social, au nom du développement, de la démocratie et du progrès social – ce qui est soit naïf (à gauche), soit hypocrite (à droite).
Alors, bien sûr, il faut espérer que la Chine, en très forte croissance aujourd’hui, connaîtra bientôt des augmentations de salaires, verra apparaître une protection sociale digne de ce nom et se mettre en place un droit du travail plus protecteur, se souciera de plus en plus de l’environnement et verra sa monnaie se réévaluer de manière plus conséquente, tout cela devant bien sûr entraîner une hausse des coûts de production. Ce sera très certainement le cas, comme ce le fut pour le Japon dans les années 60, pour la Corée dans les années 80. Les premiers signes de cette évolution apparaissent déjà, même s’il est vrai que les dimensions de la Chine rendent tout beaucoup plus complexe. Quoi qu’il en soit, le processus ne peut venir que de l’intérieur – des ouvriers profitant des tensions naissantes sur le marché du travail pour s’organiser et réclamer leur part de la nouvelle richesse, de la moyenne bourgeoisie naissante qui va avoir envie de consommer et de jouer, des gouvernements et des industriels désireux d’éviter les problèmes sociaux et politiques en suscitant une demande locale. Chacun peut accompagner et encourager cette évolution, à laquelle nous avons d’ailleurs tout intérêt, en choisissant au mieux ses partenaires ; il serait stupide de l’empêcher en croyant, ou en prétendant, l’accélérer.
Ceux qui me connaissent savent que je suis loin d’être un libéral pur et dur, et n’adhère pas à la croyance quasi religieuse selon laquelle la libre concurrence et le jeu du marché conduiraient mécaniquement au meilleur des mondes possibles – jouez à Terra et vous verrez si ça marche. Je sais donc bien que le scénario rose que je décris ci-dessus n’est pas, loin de là, le seul possible. Les éditeurs de jeux, même s’ils vendent un produit culturel pour lequel le prix n’est pas le critère principal de choix, ne peuvent pourtant pas ignorer totalement l’environnement concurrentiel dans lequel ils vivent. Quoi qu’ils pensent des arguments que j’ai développés plus haut, ils n’ont souvent pas vraiment le choix. Du Balai, fabriqué en Chine alors que la plupart des jeux Asmodée sont produits en Europe, en est une excellente illustration. Le matériel très particulier, et notamment la boite-livre conçue sur mesure pou le jeu, n’aurait pu être fabriqué en Europe qu’à un coût tel que le jeu aurait été invendable. Le choix, dans ce cas particulier, n’était donc pas là entre la Chine et l’Europe, il était entre la Chine et rien.
Though Hasbro, Mattel and the likes have been manufacturing part of their games’ production in China or other Asian countries for years, most smaller boardgame publishers, in Europe and the USA, have historically been printing and producing their games “at home”. A few, like Ravensburger, have their own cardboard and printing facilities, but most rely on subcontractors, card printers like the Belgian Carta Mundi, or game manufacturers like the german company Ludofact, who can do everything from printing, cutting cardboard and sourcing the various components required for a game, to assembling all its components into the game box, and even warehousing the resulting game.
For two years now, the trend towards outsourcing the production of games, mostly in China, has increased, to the point where it now also affects also smaller publishers. While most of my own games are still printed in Europe, more and more now display a small “made in China” mark in a discreet corner of the box back. The American edition of Citadels is now printed in China, like the American edition of Boomtown and now Warrior Knights. The Babylone pieces now come from China as well.
Game publishers “guilty” of outsourcing to China are regularly bashed on internet forums, especially in France, as if the problem and its implications were simple. They are not.
The first criticism is usually directed at the components’ quality (or supposed lack thereof) of Chinese manufacturers. Chinese cards are reputed to be difficult to shuffle, the result of a cardboard too thin or too thick, of colors too bright or too dark, and/or of a thin and fragile varnish. The boards are said to be easily prone to warping, or to often feature an ugly and distinctively un-European “American valley” in their middle, so called because there was a time when European printers were the only ones mastering the high technology behind the cutting and flat folding of boardgame boards. Some can dissert for hours on the qualitative card stock differences between boxes and tiles printed in China versus Germany. More problematic, the quality is supposed to be erratic, which means constant checking and counting of everything in order to get game boxes in time, and with no missing part. Chinese printers are said to have a careless attitute toward timelines, though Belgians are not necessarily better. All this is made even worse by the fact that, in case of trouble, contacts and discussions are much more difficult than with neighboring partners.
All this is more or less true, and the quality problems are the main reason why some publishers, after printing a few games in China, have been coming back, at least for some of their products, to Europe and North America. I usually prefer to have my games produced in Europe than in China, because I have friendly relations with the people at Ludofact, and because the games still look a bit nicer. If Diamant was a hit in Germany, it’s in part due to the nice wood and cardboard components, typically “made in Germany”. The comparison, on the other hand, is not always in favor of the American (or French) productions. You can see this with the most recent print runs of Citadels, now manufactured in China, with a better result than older versions which were, I believe, manufactured in Canada. Nevertheless, the difference in quality between Europe and China is narrowing very rapidly, if it still exists.
The most frequent and violent criticisms, however, are not about the games themselves but about the business logic behind this outsourcing. Publishers who are printing their games in China are blamed for being unscrupulous capitalists, guilty on the one hand of taking advantage of underpaid and overexploited workers, and on the other of causing unemployment in Europe and the USA. Once more, it’s not wrong, but it’s also not so simple.
Obviously, outsourcing axes the outsourced jobs in rich countries, and this is true with games as with anything else. On the other hand, it results in lower prices, and therefore diverts purchasing power towards other activities, and this diversion can create jobs, especially when these activities are services which are more labor intensive than the largely automated printing and cutting of cardboard. The global effects in terms of jobs is not easy to tally, since when games are cheaper, you buy more or, more likely, buy more of something else.
Of course, lower production costs are the main reason behind this move toward outsourcing. Printing games in China is interesting only because it’s cheaper, and cheaper enough, for that matter, to balance the higher logistics and communication costs. This is indeed due to lower wages, longer working hours, and lower social security. This doesn’t imply that, as I have read it recently on a game forum, we ought either to demand that Chinese workers were paid at American rates and got the same protection European ones, either to give up outsourcing. This would result in canceling the only competitive advantage of the Chinese industry, and the only cause behind the economic growth of China. Canceling this advantage in the name of western social norms would mean forbidding development and its consequences, democratization and social progress, in the name of development, democracy and social norms. This is either naïve (on the left) or hypocritical (on the right).
We can only hope that China, due to its very fast growth, will soon see wages rise, social security develop, labor laws enacted and applied, environment become a real concern, and its money more substantially revalued, all this causing a rise in Chinese production costs. This will happen, like it happened with Japan in the sixties and with South Korea in the eighties. It has even already started, even though things might be more slow and complex due to China’s size. All this, however, can only come from the inside, from workers taking advantage of the rising tensions on the labor market to claim higher wages, their share of this new wealth; from a rising local middle-class avid of consuming and gaming; from a government and businessmen wanting to avoid social and political tensions by creating a local demand – which has always been the ultimate goal. We can accompany and may be encourage this trend, which is in our own interest, by taking care in choosing our business partners. It would be stupid to stop it while pretending to help it.
Those who know me are aware that I’m not a free marketer and that I don’t subscribe to the quasi-religious belief that free market and competition automatically lead to a best possible world. Play Terra and you will see.
I know very well that the optimistic scenario I’ve described is not the only possible one. On the other hand, game publishers, even when they sell a cultural product for which price is not the main criterion of choice, cannot ignore the competitive world in which they are living. No matter what they think of the arguments I have developed, they often have little choice. A good example is Du Balai, which is printed in China, while most Asmodée games are still made in Europe. This is due to the components, and specifically the book-like box design of this game. If produced in Europe, the manufacturing cost would have been so high that the game would have ended up priced out of its true market potential. In this specific case, it was not a choice between China and Europe, but rather a choice between China and nothing.