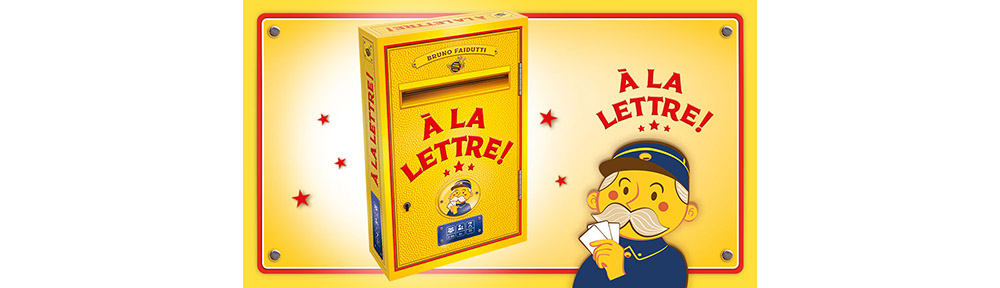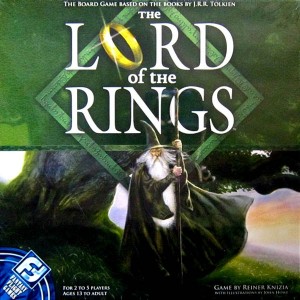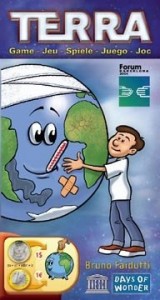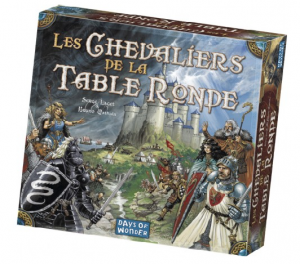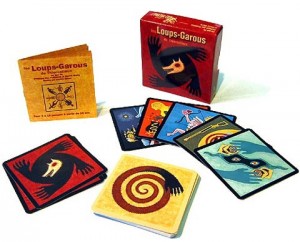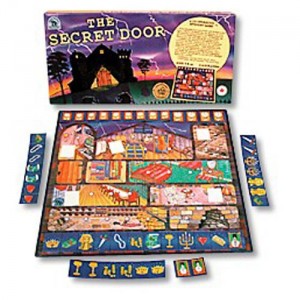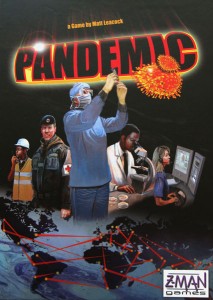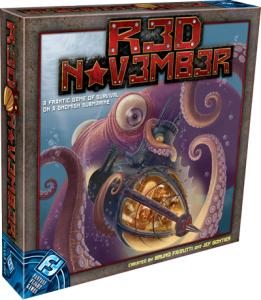J’étais, il y aune dizaine de jours, à un très sérieux colloque international sur les jeux et l’éducation. J’y ai principalement exprimé ma méfiance face à la mode du jeu éducatif, y compris le “serious games” informatique, qui bien souvent n’est plus perçu comme un jeu par les élèves, qui privilégie la réflexion analytique et stratégique déjà trop présente dans l’univers scolaire au détriment de la pensée critique, et qui, tout comme les envahissants powerpoints, finit par interdire l’improvisation et l’innovation au nom même de l’innovation. Il faudrait que je reprenne les vagues notes qui ont servi de base à mon intervention pour en faire un article rédigé et construit, mais j’avoue avoir un peu la flemme. je voudrais plutôt aborder l’une des tendances qui m’ont frappé lors des divers ateliers et débats auxquels j’ai pu prendre part – la mise en avant systématique des jeux de coopération et de collaboration.
Quel enfant n’a pas joué au Verger, publié par Haba dans sa grosse boite jaune avec plein de jolis fruits en bois . Déjà présents depuis bien longtemps dans les jeux pour enfants, le jeu de coopération a sauté le pas il y a une petite dizaine d’années pour passer dans les jeux de société pour adultes. Reiner Knizia a ouvert la voie avec le Seigneur des Anneaux, d’autres ont suivi, avec notamment Les Chevaliers de la Table Ronde ou Pandémie. Moi même, qui ne suis pas un fan du genre, ait commis le faussement politiquement correct Terra et le très peu politiquement correct Sauvez le Kursk Novembre Rouge.
Nous sommes véritablement dans le “politiquement correct”. Le jeu de coopération – et ce n’est pas par hasard que l’on préfère ce mot à celui de collaboration – est particulièrement bien vu dans deux milieux qui se recoupent assez largement, et dans lesquels je me reconnais d’ailleurs largement, les écologistes et autres anti-capitalistes un peu bobo, et les profs de gauche. Il y a à cela des raisons d’ordre moral et éthique, voire simplement esthétique, relevant de la non-violence, comme si un jeu de compétition était réellement violent. Il y a surtout des motifs politiques et économiques sur lesquels je voudrais m’attarder car ils me semblent découler assez largement d’une erreur d’analyse. L’idée, en gros, serait que le vilain capitalisme mondial est le monde de la compétition sauvage, représenté par les jeux traditionnels, auquel nous devrions opposer le monde de la gentille collaboration pour bâtir un avenir meilleur et un développement durable, illustré par les jeux coopératifs. Si je suis bien d’accord pour dire que l’on ne bâtira sans doute pas un monde meilleur à coups de fusils d’assaut et d’épées à deux mains, je pense que l’analyse du capitalisme contemporain comme un univers de pure compétition est largement, et parfois délibérément, trompeuse. Les grandes multinationales qui emploient le jeu lors de leurs formations internes utilisent aussi beaucoup les jeux de coopération pour encourager le “travail d’équipe” très productif, les “synergies”, l'”émulation”, la “culture d’entreprise” toujours hypocrite et toutes ces sortes de foutaises. Comme l’avait vu Marx, le capitalisme met bien les prolétaires en compétition les uns avec les autres, et l’aggravation récente de cette tendance remet peut-être dans l’actualité les analyses en termes de paupérisation du prolétariat. Mais, comme l’avait vu Schumpeter, dont tous ceux qui ne connaissent que le thuriféraire de l’entrepreneur innovateur oublient qu’il se revendiquait socialiste, le capitalisme moderne n’est pas seulement l’univers de la concurrence, c’est aussi celui de la connivence – des arrangements, de la combinazione diraient nos amis italiens, pas toujours non-violents. Et puis, pour changer le monde, il y a aussi des moments où il faut se révolter et se battre. Faire du jeu de compétition la métaphore de la guerre et de la concurrence sauvage et du jeu de coopération celle de la paix dans le monde et du développement durable est une gentille mais monumentale erreur d’analyse.
Certes, me répondront les gentils éducateurs, mais du moins les jeux de coopération permettent-ils d’encourager la discussion, le débat, la construction collective d’une stratégie plutôt que le chacun pour soi. Ce sont d’ailleurs des jeux où tout le monde gagne (ou perd) – contre le vilain corbeau noir ou l’œil de Sauron – et ou aucun perdant ne se sent personnellement humilié. Je leur rappellerai d’abord que, sauf cas pathologiques, le perdant d’un jeu de compétition n’a aucune raison de se sentir humilié, ni le vainqueur de se sentir fier puisque, par définition, ce n’est qu’un jeu. Dans un jeu, si l’on cherche toujours à gagner, on se moque bien au fond, ensuite, de savoir qui a gagné. Ce qui se passe dans bien des jeux de coopération est plus problématique – il n’y a ni vainqueur, ni vaincu, mais il y a souvent un leader, un guide (j’arrête les traductions avant d’atteindre le point Godwin). Les vrais jeux de coopération, et notamment ceux destinés aux plus jeunes comme Le Verger, sont en fait souvent des jeux pour un seul joueur, avec une stratégie optimale. Parfois, des joueurs d’âge, d’intérêt et de capacités équivalents vont débattre pour s’adapter aux circonstances et découvrir cette stratégie optimale mais, bien souvent, l’un d’entre eux va prendre le leadership, expliquer ce qu’il faut faire, pourquoi il vaut mieux que le corbeau mange des prunes s’il reste plus de prunes, et l’initiation à la collaboration devient entrainement au leadership et à la soumission.
Certes, des jeux tentent de contourner ce problème. Pour les plus jeunes, des jeux de construction ou d’adresse – je pense par exemple à Burgritter – obligent les joueurs à effectuer des actions à plusieurs. Dans les jeux pour adultes, l’introduction d’un possible traître, comme dans les Chevaliers de la Table Ronde ou Battlestar Galactica introduit la suspicion et empêche la franche discussion collaborative. Je trouve personnellement que cela donne à ces jeux une dimension psychologique très intéressante, mais je ne suis pas certain que la délation et la chasse au mouton noir soient précisément ce que les naïfs pédagogues vantant les jeux de coopération cherchent à encourager. Ça n’empêche pas toutes les colonies de vacances de jouer aux Loups Garous de Thiercelieux, et c’est tant mieux. On peut aussi, et c’est le choix d’Antoine Bauza dans Hanabi, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, interdire toute communication entre les joueurs – mais là, c’est le débat collaboratif qui en prend un coup. Et je ne parle pas de Space Cadets, ou chacun fait son petit jeu dans son coin – même si ça a l’air d’être un jeu diablement amusant.
Restent les jeux par équipe – un genre que j’aime assez pratiquer mais avec lequel je suis suffisamment mal à l’aise pour ne m’y être jamais vraiment essayé comme créateur. Dans un jeu par équipe – et c’est notamment vrai dans le sport – il y a à la fois de la collaboration, entre partenaires, et de la compétition, avec les autres. C’est sans doute pour cela que les sports d’équipe sont si fréquemment utilisés et mis en scène à l’école, mais eux aussi produisent des leaders et, surtout, créent un univers de jeu divisé en deux camps – pas du tout politiquement correct, ça!
Alors quoi ? Alors, sans doute, faut-il accepter une bonne fois pour toutes que l’on s’en moque, qu’un jeu n’est fait et ne peut être fait ni pour enseigner la compétition, ni pour apprendre la collaboration, mais simplement pour divertir les joueurs, et que l’on peut se divertir très innocemment l’un contre l’autre ou l’un avec l’autre tant que, justement, on ne pense pas être là pour apprendre quoi que ce soit.
A dozen days ago, i hold a conference at a very serious international symposium on games and education. I mostly expressed my wariness with the recent fashion in educative games, including the strangely named “serious games” all of which are never really considered games by students and focus on analytic and strategic thinking, which are already far too present in school, and largely discard as irrelevant any form of critical thinking. Like powerpoints, games tend to limit teachers’ improvisation and therefore innovation in learning, in the very name of innovation. I should take the bunch of notes I used in my speech and write a consistent article out of them, but i’m a bit lazy about it and would rather discuss one of the emphasis I noticed there – on cooperative and collaborative gaming.
Cooperative children games have been popular for years. Every kid in Europe has played The Orchard, a basic and mostly luck driven cooperative published by Haba with lavish wooden bits. Many American kids have played one of the – usually bad – Family Pastimes boardgames. Cooperative boardgames entered adult boardgaming with Reiner Knizia’s Lord of the Rings, and many authors followed suit with, among others, shadows over Camelot or Pandemic. Even when I’ve never been very dedicated to the genre, I designed two, the superficially and falsely politically correct Terra and the totally unpolitically correct Save the Kursk Red November.
Cooperative games are the epitome of liberal political correctness. They are very popular in two circles to which I undoubtedly belong, ecologists and similar anti-capitalists and leftist teachers – and calling them cooperative games rather than collaborative games is, especially in Europe, not a neutral choice. There are moral and ethical, if not simply esthetic, reasons to this – cooperative game looks like a non violent sort of gaming, as if competitive games were really violent. There are mostly political and economical reasons which, i think, derive from a popular but erroneous analysis. Broadly speaking, the idea is that the evil world capitalism is based on fierce competition, and is represented in competitive games, and that we ought to oppose to it the world of friendly cooperation and sustainable development embedded in collaborative games. While I agree that chainsaws and two-handed swords might not be the best fitted tools to build a better tomorrow, i also think that the prevalent analysis of contemporary capitalism as a world of pure competition, as in Mankiw’s catechism, is largely and may be deliberately misleading. Global corporations also make a heavy use of cooperative games – though they prefer to talk of collaborative gaming – to promote “team spirit” and enforce “corporate culture” and other similar bullshit. As Marx has rightly observed, capitalists tend to create competition between workers, and the recent globalization might be reviving his analysis about the gradual impoverishment of the working class. Schumpeter is often quoted nowadays as the champion of small capitalist innovators, while we forget that he was also a self proclaimed socialist and champion of state monopolies, and he was also right in describing modern capitalism as the world not only of competition, but also of arrangements, cartels, connivence – combinazione, to use the italian world, not necessarily associated with non violence. Furthermore, revolt might be necessary to change things, and can’t be always non-violent. Stating that competitive gaming is a metaphor of war or savage capitalism, and cooperative games a tool for peace in the world and sustainable development is a cute idea but a major error in reasoning.
Of course, nice and well meaning teachers might answer that, at least, collaborative games teach discussion, debate, and the collective building of a strategy rather than the usual every man for himself. Since everyone wins, or sometimes loses, against the dark raven or the evil eye of Sauron, no individual loser can feel humiliated, no individual winner can feel particularly proud of himself. Well, a common characteristic of all games is that they are just games and that winning and losing, while being fundamental when playing, doesn’t matter anymore once the game is over. What happens with many cooperative games is more problematic – there’s no winner or loser, but there’s often a leader, a guide (let’s stop with translations before we reach the Godwin point) who takes all the real decisions for all players. True cooperative games, and especially those aimed at younger players like the ubiquitous Orchard, are in fact single player games with an optimal strategy. Players of the same age, energy and abilities might collaborate to find this strategy, but most times one will seize the leadership, explain why it’s better to have the raven eat plums when there are mostly plums left, and what was designed as a tool for learning collaboration becomes a tool for learning leadership and submission.
Of course, there are technical ways to avoid the leadership issue. Some children games, like the building game Burgritter, require gamers to really act as a team when fulfilling some tasks. In adult games, the introduction of a possible traitor, like in Shadows over Camelot or Battlestar Galactica, creates strong suspicion and prevents totally open discussion. I think it brings a very interesting psychological dimension to these games, but I’m not sure denunciation and hunt for the black sheep are exactly what leftist educators want to teach. Anyway, this doesn’t prevent most summer camps to play werewolf, and that’s for the best. One can also, like Antoine Bauza did in Hanabi, forbid any communication between players – so much for collaborative debate. And I don’t talk of Space Cadets, in which each player plays his own little solo game – even when it seems to be a pretty fun game.
Team games are a genre of their own. I like playing them, but I’ve never really known how to design them. In a team game – including most sports – there’s both collaboration between partners and competition against the opposing team. That’s probably why sports are so regularly used at school – though I used to hate them as a student. The problem is that they also encourage leadership, and create a game world divided in two sides – not very politically correct either.
So what ? Let’s agree that we don’t really care, that a game is never designed to teach competition or collaboration but just to give the players some fun or excitement, and that it’s perfectly healthy to play one against the other or one with the other, as long as it’s just a game and noone thinks he’s learning anything.