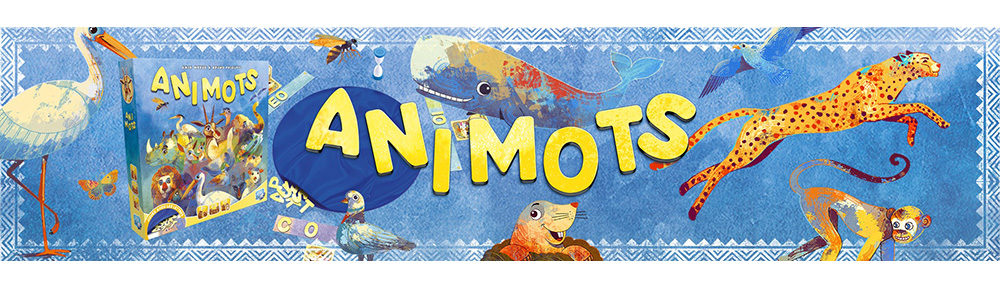(Oui, je sais, j’ai déjà écrit à ce sujet sur ce blog, il y a une dizaine d’années, j’avais oublié et ne m’en suis aperçu qu’après avoir rédigé ce nouvel article)
Lorsque, dans les années quatre-vingt, j’ai commencé à m’intéresser aux jeux de société, ceux-ci appartenaient à deux écoles bien distinctes, que nous avions baptisées simplement américaine et allemande. Les jeux américains, comme Dune, Britannia, Junta ou Cosmic Encounter, avaient de longues règles rédigées en anglais, et imprimées en tout petits caractères. Les jeux allemands, comme Scotland Yard ou Le Lièvre et la Tortue, et plus tard Les Colons de Catan, nous parvenaient avec des règles plus courtes et aérées mais rédigées en allemand, et ce même lorsque leurs auteurs, comme David Parlett ou Alex Randolph, étaient anglo-saxons. Comme nombre de mes amis joueurs, j’avais d’abord étudié l’allemand au lycée, choix apparemment absurde qui était en fait une espèce de code secret de la bourgeoise française permettant de regrouper ses enfants dans les mêmes classes des lycées publics. Nous nous sentions pourtant déjà bien plus à l’aise avec les règles plus complexes et plus longues des jeux américains.
Lire des règles en anglais
Aujourd’hui, alors que le marché a explosé et que la quasi-totalité des jeux sont disponibles en français, je préfère encore, lorsque cela ne me coûte pas beaucoup plus cher, me procurer des éditions anglaise ou américaine. Je regrette beaucoup que cela soit devenu plus difficile, Philibert ayant, entre autres, largement cessé de vendre les versions en anglais des jeux disponibles en français.
Le texte anglais est généralement le texte d’origine, celui sur lequel auteur et éditeur ont travaillé – et pas seulement lorsque auteur et éditeur sont anglais ou américains. Ce livret de règles est donc plus soigné, plus précis, relu et testé avec soin, ce qui est rarement le cas des traductions. La version française, le plus souvent traduite de l’anglais, peut contenir des imprécisions, des ambiguïtés, des lourdeurs, voire des erreurs de traduction. Il y a encore une dizaine d’années, les règles françaises étaient souvent truffées d’erreurs et, même dans le cas où elles n’étaient pas traduites, de fautes de grammaire rendant la lecture difficile et souvent le sens ambigu. Il y a eu de nets progrès ces dernières années, les éditeurs font de plus en plus appel à des traducteurs, rédacteurs et même relecteurs compétents, mais je n’en continue pas moins à préférer lire les règles dans ce qui me semble être leur langue naturelle, l’anglais.
Écrire des règles en anglais
Parmi les conseils aux jeunes auteurs que je donne assez régulièrement, celui qui surprend parfois le plus mais pour lequel on m’a ensuite souvent remercié est de rédiger, dès la toute première version du jeu, cartes et règles, en anglais. C’est ce que je fais depuis une trentaine d’années, et cela n’empêche absolument pas d’utiliser le français lorsque l’on explique ces mêmes règles à ses amis joueurs.
Bon, d’accord, il y a des bons jeux dont traduire la règle ne présente guère d’intérêt.
Une langue plus adaptée
Je ne crois pas à la théorie bizarre qui voudrait que chacun pense dans sa langue, et que ceux qui pratiquent une langue différente pensent différemment. Cela me semble être au mieux de la pensée magique, au pire un dernier avatar du « racisme scientifique » (ces gens-là ne pensent pas comme nous, ils ne sont donc pas comme nous). Il n’en reste pas moins que si le langage n’influe guère sur la pensée qui le précède, il permet et contraint à la fois la communication qui la suit. On peut tout dire dans toutes les langues, mais certaines sont mieux adaptées à certains usages. C’est ce que Voltaire appelait « le génie de la langue », et c’est pour cette raison que son pote Frédéric II parlait « en espagnol à Dieu, en français aux hommes, en italien aux femmes et en allemand à son cheval ».
L’anglais est plus adapté, mieux équipé que le français pour la rédaction de textes techniques et directifs comme une règle de jeu. Tous ceux qui ont essayé de lire en français le mode d’emploi d’un appareil électro-ménager ou d’un logiciel savent que c’est une tâche difficile, là où le texte anglais est généralement limpide. À en croire les auteurs de jeux italiens avec qui j’ai abordé cette question, leur langue serait encore pire que le français. Mes rudiments de latin, polonais, japonais et allemand ne me permettent pas de me prononcer avec certitude, mais j’ai le sentiment que, à l’exception peut-être de la dernière, ces langues ne sont pas très adaptées non plus.
Pour rester simple
Une autre raison, qui ne contredit pas la précédente, est que rédiger en anglais, langue que je maîtrise à peu près mais bien moins que le français, m’aide à écrire des règles simples, directes, sans fioritures inutiles. C’était déjà utile il y a une vingtaine d’années, cela l’est plus encore aujourd’hui, sur un marché passablement encombré, et alors que la qualité de conception et de rédaction des règles a progressé. Un jeu trop complexe, ou dont les règles sont présentées de manière trop alambiquée, a bien peu de chances de trouver un éditeur, et moins encore de rencontrer le succès. En travaillant en anglais, les auteurs non anglophones comme moi se forcent à aller droit au but, avec des règles claires, directes, complètes mais aussi brèves que possible.
Pour tout le monde
Ils se donnent aussi plus de chances de rencontrer des éditeurs. La principale raison pour écrire les règles en anglais est en effet de pouvoir ensuite présenter facilement son jeu aux éditeurs du monde entier, français compris. Le petit monde de l’édition ludique est en effet très international, bien plus que celui de l’édition littéraire. Il y a certes encore quelques petites différences régionales, plus d’ailleurs dans le graphisme et la présentation des jeux que dans leur nature, mais l’éditeur princeps d’un jeu imaginé par un auteur français, brésilien ou japonais peut très bien être américain, coréen ou polonais, et inversement. Tous ces gens-là discutent, et le plus souvent travaillent, en anglais. Même un éditeur français préfèrera le plus souvent un prototype en anglais, parce que, comme je l’ai expliqué plus haut, les règles en seront plus claires, mais aussi parce que cela lui permettra de présenter facilement le jeu à des étrangers intéressés par une licence ou un contrat de distribution.
Contre-argument
Paradoxalement, la seule raison pour écrire des règles de jeu en français, ou dans votre langue maternelle, quelle qu’elle soit, est que vous devrez finalement, au moment de présenter le jeu à des éditeurs, le traduire en anglais. La traduction est en effet très souvent l’occasion de repérer les petits oublis dans les règles, les passages inutiles ou redondants, voire même, cela m’arrive encore un peu trop souvent, les résidus d’anciennes versions.
Deux jeux qui traitent de traduction. Il faudrait que j’en fasse un aussi.
(Je reprends à peu près la conclusion d’un autre article de ce site, écrit il y a une dizaine d’années, car je n’ai pas grand-chose à y ajouter ou à en retirer)
Il existe en France un lobby (devrais-je dire groupe de pression ?) autoproclamé, paranoïaque et influent de « défenseurs de la langue française » qui voient dans tout usage de la langue anglaise par un français un acte de trahison. Leur conception de la culture comme un jeu à somme nulle où ce qui est gagné par les uns serait perdu par les autres est, au regard de l’histoire, d’une grande naïveté. L’anglais est aujourd’hui devenu un vecteur culturel, un outil qui, en facilitant les contacts entre les hommes, les textes, les cultures, ne peut que les enrichir tous. Il remplit en ce sens la même fonction que le latin à la Renaissance, et la remplit sans doute mieux encore puisque son usage ne se limite plus aujourd’hui aux milieux lettrés. On peut trouver ironique que l’anglais soit aujourd’hui la seule lingua franca, mais il vaut mieux se réjouir qu’il y en ait une, et en faire le meilleur usage, que perdre son temps en vains regrets et son énergie en excommunications et combats d’arrière-garde.
(Yes, I know, I have already written a blogpost on this topic, a dozen years ago. I had forgotten about it and only found out after having nearly finished this new one. I’m fascinated by languages and language theory, which explained why I often come back to it.)
When, in the eighties, I started getting interested in modern boardgames, the ones I had access to belonged to two different design schools, which me and my friends called American and German. American school games such as Dune, Britannia, Junta or Cosmic Encounter had relatively long rules written in English, and in a very small font. German games such as Scotland Yard or Hare and Tortoise, and soon Settlers of Catan, had shorter rules with a more airy layout, but the editions we had access to were written in German, even when their designers, like David Parlett or Alex Randolph, were English speaking. Like many of my friends, I had first studied German in school, a seemingly absurd choice which was in fact a kind of secret code used by the French upper class to put all their kids in the same classes of state schools. Despite this, we were all much more at ease with the longer and more complex rules of American games.
Reading rules in English
Even now, when the marker has skyrocketed and most games are available in French, I prefer, when it’s not much more expensive, to get English language versions of new games. It is unfortunately becoming more and more difficult, especially since Philibert has nearly stopped selling English language versions of games they also have in French.
The English text of the rules is usually the one on which designer and publisher have worked, and not only when they are both American or English. The English language rulebook is therefore more carefully written, more precise, proofread and playtested many times, which is rarely the case with translations. The French version, usually translated from the English one, can have ambiguities, heavy wordings, even mistranslations. Ten years ago, French rules, even when they were not translated, used to be full of grammar errors, making them painful to read and often ambiguous. There has been much progress these last ten years, French publishers having gotten used to rely on professional translators, redactors and even proofreaders, but I nevertheless still prefer to read rules in what feels to me like their natural language, English.
Writing rules in English
One of the advice I regularly give to wannabe (non English speaking) game designers is to write every element of their prototype, be it rules or cards, in English, and to do this from the start, from the first iteration of the prototype. It is also the advice for which I have been thanked the most often. That’s what I do for thirty years now, and it doesn’t prevent anyone to use their native language when explaining the game to their playtester friends.
OK, there are a few really good games it would be pointless to translate.
A better fitting language
I don’t believe in the strange trendy theory according to which everyone thinks in their native language and people using different languages therefore think differently. It seems to me to be at best magical thinking, at worst the last avatar of “scientific racism” – these people don’t think like us, so they cannot be like us. Nevertheless, while language barely affects thought, because thought largely precedes it, it both allows and constrains the communication of thought. We can say more or less everything in every language, but some languages are better fitted to certain uses. Voltaire used to call this the “genius of language”, and it is why his buddy the King of Prussia Friedrich II said that “I speak in Spanish to God, in French to men, in Italian to women and in German to my horse”.
English is better fitted to the writing of technical and prescriptive texts, such as game rules. Anyone who has tried to decipher the French version of some household appliance or computer software instructions knows that it is nearly impossible, when the English version is usually crystal clear. I’ve discussed this with Italian game designers who maintain that their language is even worse than French. My very basic knowledge of Latin, Polish, Japanese and German doesn’t allow me to say it with certainty, but I have the feeling that, with the possible exception of the last one, these languages are not very suitable either.
Keeping it simple
Another reason, which does not contradict the former one, is that using English, a language I don’t master as well as French, helps me to write simple, direct, straight to the point rules. This was already useful twenty years ago, it is even more now. The market is becoming overcrowded, the average quality both of the games themselves and of their rules has vastly increased. A game whose rules feel too convoluted, no matter whether they are indeed complex or just badly written, is unlikely to find a publisher, and even more unlikely to be a hit. For non-native speakers like me, English can help to write clear, direct, simple and short rules.
A language for everyone
Most of all, English rules helps when contacting publishers. The main reason for using English is that it makes possible to show one’s game to publishers from any country, France and other exotic markets included. The small game publishing world is largely, if not globalized, at least internationalized, far more than the book publishing one. There are still minor local differences, more in the art and packaging than in the games themselves, but the princeps publisher of a game designed by a French, Brazilian or Japanese designer can be American, Korean or Polish, and vice versa. All these people talk with each other, and often work, in English. Even a French publisher is more likely to consider an English language prototype, because its rules will be clearer, as I explained above, but also because it makes easier to show the game to foreigners who might be interested in localizing or distributing it.
Counter-argument
Paradoxically, the only good reason to start with rules in French, or un your own language, is that, in the end, you will have to translate everything in English in order to show it to publishers. Translating a text is a very efficient way to check small omissions and redundancies in the rules, or even, it stil occasionally happens to me, small residues from older versions which should have been deleted.
Two games about language and translation. I should design one someday.
(This conclusion is almost copy-pasted from the one I wrote ten years ago, because unfortunately I have little to add or remove to it. )
We have in France a self-proclaimed, paranoid and influential lobby of “champions of the French language” who regard every use of the English language by a French as an act of treason. They naively consider culture to be always a zero-sum game, where what is won by some is necessarily lost by others. English is now a cultural tool that helps contacts between people, between texts, between cultures, and it’s an all-win game. English works a bit like Latin during the Renaissance, and works even better because its use is not limited to well-read scholars. Of course, there’s something ironic in English being the only lingua franca, but we ought to rejoice that there’s one, and make the best use of it, rather than waste time in vain regrets and energy in excommunications and rearguard actions.